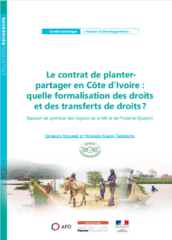
Dans les campagnes ivoiriennes, les rapports socio-fonciers sont structurés autour de divers arrangements institutionnels marchands et non marchands d’accès à la terre (prêt, mise en gage, location, métayage, achat-vente, etc.) se caractérisant souvent par des conflits interethniques et intrafamiliaux. Dans un contexte de renouvellement des générations, ces arrangements fonciers conclus par le passé par les anciennes générations sont souvent contestés, ce qui constitue une source majeure de tensions et conflits entre les populations autochtones, propriétaires originels des terres, et les allochtones et allogènes. Socialement enchâssés, ces transferts fonciers sont sanctionnés généralement par des contrats ou conventions locales, écrites ou non, qui ne sont pas reconnus par la politique foncière nationale et ses textes d’applications (loi foncière de 1998, 2004, 2013 et 2019) qui ont jusqu’à présent mis l’accent dans sa mise en œuvre sur la Délimitation des Territoires Villageois (DTV) et la certification foncière.
Ce document de recherche documente plus particulièrement la pratique du planter-partager (P&P) dans la région de la Mé et de l’Indénié-Djuablin, et plus particulièrement deux aspects ignorés ou peu traités par les travaux antérieurs, à savoir 1/le traitement de ces contrats (dans leur diversité) dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de formalisation des droits fonciers (certification puis titrage) et des transferts de droits (procédures contractuelles formelles) ; et 2/ les rapports fonciers au sein des familles des cédants, susceptibles d’influer sur les logiques des transferts et d’être porteurs de tensions intrafamiliales (pouvant se répercuter sur les preneurs).
A partir d’une approche qualitative, l’étude met en lumière les risques de fragilisation par la procédure officielle de formalisation des droits de certains acteurs de ces pratiques, et notamment les preneurs de parcelles foncières (jachères, forêts) ou de cultures (vieilles plantations). Elle recommande un changement de paradigme dans la conduite des opérations de sécurisation foncière, et de mettre l’accent sur la délivrance de contrats formels sur les terres non certifiées ou en cours de délivrance de certificats fonciers, sous l’égide des Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale (CVGFR).

Rejoignez-nous sur
LinkedIn