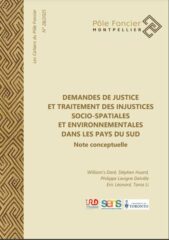Conflits
Les conflits possèdent souvent une forte dimension agraire et foncière, souvent sous-estimée.
Le contrôle de la terre et de l’accès aux ressources naturelles suscitent en effet des formes de concurrence, pouvant déboucher sur des tensions et des violences, impliquant plusieurs types d’acteurs.
Différentes configurations de conflits sur la terre ont été identifiées dans le chapitre publié dans l’ouvrage de référence « le foncier rural dans les pays du Sud. Enjeux et clés d’analyse » (QUAE, 2022).
Il propose de raisonner la typologie des conflits en fonction de plusieurs paramètres : les droits, le contenu des droits, les obligations associées, l’identité des protagonistes des conflits, et les autorités aptes à les réguler.
Ce travail repose sur une analyse transgéographique en essayant de brasser des données empiriques extrêmement larges.
Il distingue :
- Les conflits autour des obligations sociales associés aux droits en distinguant trois cas : (i) obligations au sein des groupes domestiques ; (ii) obligations dans le cadre coutumier villageois ou (iii) conflits de détachement ou remise en question du tutorat ;
- Les conflits d’usage entre catégories d’exploitants d’une ressource en accès partagé ;
- Les conflits liés à la marchandisation de la terre ;
- Les conflits sur les limites des patrimoines et des parcelles ;
- Les conflits liés à la pluralité et au chevauchement des systèmes d’autorité ;
- Les conflits induits par des processus de dépossession, avec cinq cas possibles : (i) conflits intrafamiliaux ; (ii) liés à des déplacements forcés ; (iii) appropriation privative de terres en accès partagé (iv) dépossessions individuelles dans le cadre d’interventions foncières (v) dépossessions collectives, en lien avec des revendications territoriales.
Les conflits se focalisant autour du foncier peuvent également avoir une dimension historique et politique, notamment en cas de différends entre groupes socio-ethniques et d’instrumentalisation par les pouvoirs politiques. De nouveaux conflits se sont également accentués ces dernières années à travers des situations d’appropriation et de concentration des terres à grande échelle, communément appelées « accaparement des terres ».
La thèse dominante chez les politiques (des pays du Nord comme du Sud) et les institutions financières internationales qui les influencent, consiste à dire que la raison principale qui fait de la question foncière un déclencheur ou un facteur de conflit vient de l’inexistence ou de l’insuffisance d’un cadre légal formel et effectif, qui clarifie et sécurise les droits existants. Selon cette thèse, un tel cadre légal nécessiterait la mise en œuvre d’une législation foncière fondée sur l’enregistrement de titres de propriété privés. Seul un tel cadre légal correctement formalisé serait en mesure de pacifier les relations sociales autour de la terre en substituant à la violence, la paix du marché et à la politisation de la question foncière, la légitimité de la loi. Pourtant, la solution des problèmes fonciers par le titre de propriété privée n’est pas toujours possible à mettre en œuvre et son efficacité est loin d’être prouvée. Au contraire, une politique de certification et de privatisation des droits coutumiers peut être elle-même source de conflits.
Cette rubrique propose un ensemble de ressources permettant d’éclairer le rôle joué par la question foncière dans les conflits. Ces ressources s’articulent à des textes de référence illustrant la diversité des enjeux liés aux conflits fonciers dans ses différentes dimensions : sociales, économiques, juridiques et politiques.